Croiser les données techniques et les données de comptage constitue une première étape, mais le monitoring de demain devra aller encore plus loin. Le réseau devient de plus en plus sollicité, bidirectionnel et difficile à modéliser finement. Chaque point du réseau, en particulier en basse tension (BT), peut désormais être à la fois consommateur et producteur. Dans ce contexte, il ne s’agira plus seulement d’observer, mais bien d’anticiper des scénarios complexes.
Aujourd’hui, les modèles de simulation sont relativement performants en haute (HT) et moyenne tension (MT), mais restent encore peu précis en BT. Or, c’est justement à ce niveau que les défis apparaissent déjà : production solaire, bornes de recharge électrique ou encore pompes à chaleur se multiplient dans les quartiers résidentiels, avec des effets locaux parfois imprévisibles et des risques de congestion.
Dans ce contexte, « une exploitation intégrée et dynamique des données SCADA, comptage et topologie ouvrira de nouvelles perspectives » explique Vincent. « Cette approche permettra notamment d’anticiper des congestions et d’activer potentiellement des scénarios de flexibilité ». Autrement dit, lorsqu’une surcharge locale sera détectée, il sera possible d’agir de manière ciblée sur certaines charges pilotables, comme des systèmes de chauffage ou des infrastructures de recharge de véhicules électriques non essentielles. Ce type d’intervention contribuera à soulager temporairement le réseau sans perturber les usages prioritaires. Ce n’est qu’en dernier recours, si les marges de flexibilité sont insuffisantes, qu’un délestage temporaire, par exemple d’un quartier, pourrait être envisagé pour garantir la stabilité du système. C’est aussi dans cette logique que certains GRD adaptent déjà leurs pratiques, par exemple en rendant obligatoire le raccordement de certains équipements (e.g., pompes à chaleur, bornes de recharge, chauffe-eau, onduleurs) aux relais des compteurs intelligents. L’objectif : favoriser une gestion plus fine et plus réactive, en prévision des évolutions à venir.
Vincent souligne également que le pilotage du réseau devra être renforcé, via notamment « une optimisation en temps réel du réseau et des décisions opérationnelles proactives ». Il ne s’agira plus uniquement de réagir à un incident, mais d’adopter une posture plus anticipative, en s’appuyant sur des outils capables de prendre en compte l’évolution des charges et des injections en continu. Cette anticipation est importante pour optimiser les décisions techniques et limiter les interventions lourdes. Finalement, l’un des objectifs majeurs sera « l’évitement de renforcements coûteux en valorisant mieux l’existant, pour un réseau plus agile, durable et économiquement responsable vis-à-vis des clients », comme le résume Vincent.
Dans cette dynamique, la future plateforme nationale de données, dont la mise en service est prévue début 2027, apportera aussi de nouvelles possibilités. Si elle n’introduit pas de nouveaux outils directement pour des gestionnaires de réseau comme Romande Energie, elle permettra par exemple de produire des bilans consolidés à l’échelle d’une commune ou d’un canton, et surtout d’offrir un terrain de jeu pour des prestataires tiers, qui pourront développer des services innovants sur la base de ces données standardisées.

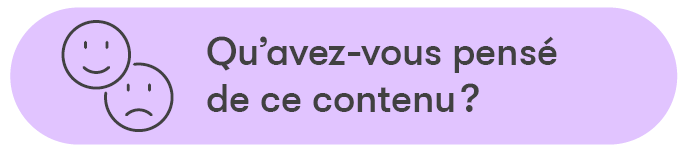



Commentaires 0