La crise énergétique qui a découlé de la guerre en Ukraine a fait planer le risque de pénurie d'électricité en Suisse en 2021-2022, et la Confédération a pris une série de mesures pour y répondre. Avec la récente coupure électrique dans la péninsule ibérique, les craintes sur la fiabilité de notre approvisionnement énergétique ont ressurgi dans les débats. Il s'agit bien entendu d'évènements radicalement différents, depuis leurs causes jusqu'à leurs conséquences : le premier révélait une inquiétude quant à notre capacité à disposer d’assez d'énergie, tandis que le second relève des possibilités de défaillance technique. Pourtant, la notion de résilience énergétique tire un trait d'union entre ces deux évènements à large couverture médiatique.
Résilience énergétique

L'essentiel en 3 points :
Résilience alimentaire, énergétique, climatique, écosystémique : le mot est à la mode, mais de quoi s'agit-il ?
La résilience d'un système est définie par sa capacité à résister aux chocs. Appliquée à l'énergie, elle revient donc à maintenir ou rétablir un approvisionnement fiable et abordable en cas de crise, ou à limiter les effets d’un défaut d’approvisionnement. En d'autres termes, il s'agit de réduire les impacts d'un évènement, qu'il soit technique, géopolitique ou financier. Associée à la décarbonation, la résilience doit être un objectif majeur pour garantir notre sécurité économique et sociale.
Production indigène et géopolitique
Pour assurer l'approvisionnement en énergie, il faut des ressources minérales pour construire et exploiter les centrales produisant de l’électricité renouvelable, ou des combustibles fossiles pour alimenter les machines et véhicules. En Suisse, nous n'avons ni l'un ni l'autre. En d'autres termes, la résilience énergétique passe avant tout par la sécurité des filières d'approvisionnement en ressources et produits finis. Les énergies de flux (solaire, éolien) sont alors préférables aux énergies de stock (fossiles) : une fois les infrastructures construites, le besoin en approvisionnement hors du pays est largement réduit. De ce point de vue, on peut donc tirer cette première conclusion simple : la résilience énergétique est facilitée par des relations internationales apaisées et une préférence pour les énergies renouvelables indigènes plutôt que fossiles.
Il faut cependant prendre quelques précautions : la crise énergétique de 2021, causée par les tensions internationales, a montré que le coût d'approvisionnement des différentes sources d'énergie était étroitement lié. Une flambée du prix du gaz, et toutes les énergies subissent le même sort, même le pellet issu du sapin de la forêt voisine.
Fiabilité du réseau
Au-delà de la disponibilité des ressources, la capacité à acheminer l’énergie produite jusqu'aux utilisateurs, qu’elle soit renouvelable ou fossile, est primordiale. Faisons donc un focus sur les réseaux électriques, qui nous renvoie au blackout récent en Espagne. Le rapport officiel du ministère espagnol a démontré que l’énergie solaire n’était pas la cause première, même si la déconnexion presque simultanée de deux centrales d’envergure a précipité la chute.

De ce point de vue, la pénétration croissante des énergies renouvelables peut être considérée comme un risque. Aucune preuve n'a été apportée qu'un réseau basé principalement sur les renouvelables est moins fiable, mais force est de constater que notre expérience de ce type de réseau est moins importante. Nous exploitons des réseaux électriques depuis des dizaines d'années basés sur des machines synchrones qui convertissent l’énergie mécanique en énergie électrique (turbines, centrales thermiques, etc.), et apportent certaines garanties. Même si la question de la stabilité du réseau est extrêmement complexe, on peut retenir que les machines synchrones apportent de l’inertie au système : leur réaction progressive en cas de défaillance nous permet de disposer de temps pour effectuer des actions correctives. Passer de centrales thermiques aux énergies renouvelables revient à simuler cette inertie avec de l'électronique de puissance. La technologie est fiable et mature, et il est désormais acquis que ce remplacement est techniquement possible. Le mettre en œuvre à grande échelle reste un défi important à tout point de vue : technique, financier, sociétal.
Une question d'échelle ?
Les milieux professionnels et essayistes de l'énergie débattent de la bonne échelle à laquelle penser la résilience : celle-ci doit-elle être locale (à l'échelle du bâtiment, du quartier, voire de la commune) ou à un niveau plus large, comme celui de la Confédération ? La redondance entre les différentes échelles est pourtant la clé de la résilience, et des solutions existent à chaque niveau. Par exemple, en cas de choc d'approvisionnement, des batteries dans l’habitat ou le quartier permettent de disposer d’un peu d’énergie. À l’échelle de la commune, les services essentiels doivent pouvoir être assurés en cas de défaillance : les hôpitaux disposent pour cela de génératrices de secours en mesure de prendre le relai du réseau. Même si la source de ces génératrices est fossile, sa très faible utilisation la rend peu émettrice de carbone.
À un niveau plus large, le plan OSTRAL est un excellent exemple de résilience pensée à l'échelle de la Confédération. Suite à la crise énergétique, ce plan a introduit des mesures destinées à réduire les consommations en cas de déficit d'approvisionnement. Ces actions permettent d'anticiper les pénuries et d'établir une répartition équitable de l'énergie entre les utilisateurs. Les mesures telles que le contingentement et les délestages tournants sont mises en place pour répondre à différents niveaux de risque, garantissant ainsi une réponse progressive et adaptée en cas de crise.
Ère de l’abondance
La résilience ne doit pas être pensée comme notre unique capacité à rétablir le niveau de consommation avant crise. Prenons un exemple simple et extrême d’une explosion soudaine des prix de l’énergie : est-on plus résilient si nous avions planifié en amont les mesures pour diminuer drastiquement notre consommation, ou si nous avions provisionné une année complète de combustibles fossiles selon notre rythme de consommation actuel ? La première mesure est pérenne, alors que la seconde s’éteint lorsque les cuves sont vides.
L’énergie abondante, adaptée à notre demande plutôt qu’à notre besoin est devenue la norme. Nous attendons naturellement de nos fournisseurs d’énergie cette disponibilité sans limites. Selon le rapport d’activité de l’Elcom de 2024, le SAIDI, qui reflète la durée de défaillance moyenne sur l’année pour un consommateur d’électricité en Suisse était de 8 minutes en 2024. Cela signifie que votre gestionnaire de réseau arrive à vous approvisionner en moyenne plus de 99,99% du temps ! Et cela sans vous imposer d'éteindre votre chauffage lors des pénuries, ou vous limiter d'une quelconque manière dans votre consommation. Passer de 90% à 99%, puis 99,9, puis 99,99, est un véritable exploit qui reflète une fiabilité sans faille. On pourrait dès lors imaginer repenser nos modes de consommation pour nous adapter à une disponibilité moindre en cas de crise.
L'électrification, atout ou faiblesse
Notre approvisionnement énergétique actuel, très majoritairement fossile, nous rend extrêmement dépendants de la stabilité des relations internationales. En revanche, on peut penser qu'il limite l'impact d'une défaillance des réseaux électriques, par rapport à une situation tout électrique. Intéressons-nous à notre cas individuel. À première vue, si l'on se chauffe au bois et utilise une voiture thermique, on risque de moins subir les effets d’une coupure généralisée qu'avec une pompe à chaleur et une voiture électrique. À première vue seulement. Car quand le réservoir est vide et le stock de bois épuisé, il n’y a plus non plus de station essence fonctionnelle pour aller en forêt avec sa voiture et démarrer sa tronçonneuse. En revanche, si on bénéficie d'une production locale photovoltaïque et d'un peu de stockage, le réapprovisionnement en chaleur et mobilité est plus aisé. Il est alors possible de choisir si l’on préfère utiliser les quelques kWh disponibles pour aller voir un parent, maintenir une température plus élevée, aller sur TikTok ou charger sa tronçonneuse pour maintenir le stock de bois.
Il s'agit bien sûr d'une illustration qui fait débat, ce n'est pas si simple. Mais cela permet de comprendre comment il est possible d’améliorer la résilience énergétique : il faut penser une redondance entre les échelles, identifier et cibler les usages indispensables et non nécessaires, revoir et flexibiliser ses besoins.
En réalité, le niveau actuel d'électrification et l'intensification massive de la numérisation rendent dès à présent l'économie paralysée en cas de coupure, et il n’est pas possible de faire machine arrière. En revanche, l’électrification intensive permet de mieux choisir entre les usages que l'on souhaite conserver. On peut dès lors décider d'acheminer un peu d'électricité à l'hôpital ou au laser game, alors qu'il est plus difficile techniquement de choisir entre alimenter une voiture thermique ou un réfrigérateur électrique.
Conclusion
Notre dépendance croissante à l’énergie et la paralysie que peut entraîner une défaillance doivent nous inviter à anticiper et limiter les effets des crises énergétiques. Les solutions doivent être pensées à l’échelle du bâtiment, de la commune, de la Confédération… mais aussi de notre intégration continentale, notamment en négociant des accords bilatéraux avec l’Union Européenne. En définitive, qu’il s’agisse de tensions géopolitiques ou de défaillances techniques, les événements récents soulignent une même nécessité : celle d’inscrire la résilience dans la stratégie énergétique.
En tant que source d'information, le blog de Romande Energie offre une diversité d'opinions sur des thèmes énergétiques variés. Rédigés en partie par des indépendants, les articles publiés ne représentent pas nécessairement la position de l'entreprise. Notre objectif consiste à diffuser des informations de natures différentes pour encourager une réflexion approfondie et promouvoir un dialogue ouvert au sein de notre communauté.

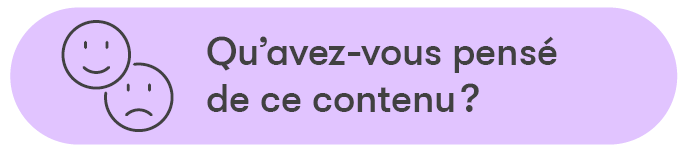


Commentaires 0