Inondations, vents, éboulements, tremblements de terre, mais aussi cyberattaques, autant de menaces qui pourraient bouleverser notre approvisionnement énergétique. Fin 2024, le Château de Morges leur a dédié une exposition intitulée « Y a le feu au lac ! », rappelant qu’il est impossible de tout éviter, mais que l’on peut réduire les risques grâce à deux principes fondamentaux : gouvernance et anticipation.
Gestion des crises énergétiques : se préparer à l’imprévisible

L'essentiel en 3 points :
On a parfois tendance à l’oublier, mais les risques et les catastrophes naturelles ont toujours fait partie intégrante de l’histoire de la Suisse. « Les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient », rappelait une affiche en début de visite de l’exposition « Y a le feu au lac ! ». Et les crises ne s’arrêtent ni aux questions climatiques, ni aux frontières : la guerre en Ukraine a soudainement rebattu les cartes, perturbant l’approvisionnement énergétique de toute l’Europe.
Toutefois, l’histoire helvétique montre que notre pays a su tirer son épingle du jeu grâce à des efforts collectifs constants. L’éboulement de Goldau en 1806, la chute du glacier de Giétro en 1818 ou encore les inondations de 1868 ont marqué le territoire, mais aussi les esprits. Ces drames ont permis d’instituer une collaboration intercantonale et de développer des lois dédiées à la protection des zones habitées. « L’union fait la force », rappelait l’exposition, soulignant l’importance de tirer les leçons du passé.
Cyberattaques et réchauffement climatique
Si la Suisse a été relativement épargnée par les grands conflits mondiaux, elle doit aujourd’hui faire face à des défis d’un autre genre : la montée en puissance des cyberattaques et les effets du dérèglement climatique. Sur le plan environnemental, le pays fait face à des événements récurrents : avalanches, éboulements, crues, etc. Ces phénomènes, amplifiés par les changements climatiques, fragilisent un territoire déjà complexe. Dans un monde hyperconnecté, les infrastructures critiques – barrages, centrales nucléaires, conduites de gaz, lignes à haute tension – deviennent également des cibles potentielles de cyberattaque. Une atteinte, même mineure, peut déclencher des effets en cascade. L’exemple du gazoduc Transitgas, qui traverse le pays pour acheminer une énergie équivalente à la production de 25 centrales nucléaires, illustre parfaitement l’importance de la vigilance. Stratégiquement indispensable à l’approvisionnement européen en gaz, il est placé sous haute surveillance. Une atteinte – qu’il s’agisse d’une cyberattaque ou d’un glissement de terrain – aurait des conséquences catastrophiques, coupant le gaz à des milliers de ménages et d’entreprises en Suisse et en Europe.
Gouverner et entretenir
Comment prévoir l’avenir dans un monde en mutation, marqué par la multiplication des crises et une lisibilité toujours plus incertaine ? L’histoire le démontre : une bonne gouvernance repose sur une capacité d’anticipation. Mais aujourd’hui, la gestion des crises se complique avec la transnationalité des menaces et la multiplication des acteurs impliqués. L’approvisionnement énergétique, essentiel au fonctionnement de notre société, dépend autant des infrastructures de production que de leur entretien. Barrages, centrales nucléaires, réseaux de gaz ou lignes électriques : ces installations stratégiques doivent être sécurisées et régulièrement mises à jour.
L’alerte précoce, clé de la prévention
En mai 2023, le village de Brienz dans les Grisons a dû être évacué face à un éboulement imminent de deux millions de mètres cubes de roche. Grâce à un système d’alerte précoce, les 84 habitants ont pu être mis à l’abri à temps. Cet exemple illustre l’importance d’une prévention proactive pour sauver des vies et réduire les dégâts matériels.
Rappelons qu’environ un tiers du territoire suisse est montagneux, un relief particulièrement vulnérable aux changements climatiques. Chaque année, la Confédération investit 2,9 milliards de francs pour se prémunir contre les dangers naturels. Parmi les outils les plus précieux figure l’alerte précoce, qui s’appuie sur la sensibilisation, la diffusion rapide d’informations et le maintien d’unités d’intervention rapide. Et ce n’est pas tout : en 2025, la Suisse prévoit la mise en place d’un système d’alerte précoce dédié aux sécheresses. Une avancée nécessaire dans un contexte de pénuries croissantes.
Quelques dates marquantes
Depuis toujours, la Suisse a été touchée par des désastres.
Voici quelques exemples :
563 Tsunami « Tauredunum » sur le Léman
1347-1352 Peste noire
1356 Tremblement de terre à Bâle
1798 Invasion de la Suisse par les troupes de Napoléan Bonaparte
1806 Éboulement de Goldau
1818 Chute du glacier de Giétroz
1830 Épidemie de choléra
1918 Épidemie de grippe espagnole
1940-1945 Bombardement en Suisse (2nd guerre mondiale)
2000 Vague torentielle à Gondo
2020 Épidemie de Covid-19
2022 Guerre en Ukraine
2023 Éboulement à Brienz
2025 Effondrement du glacier du Birch
« Il faut garder une certaine souplesse pour s’adapter à l’inattendu »
En décembre 2024, le Canton de Vaud publiait sa Revue intermédiaire des risques, un document stratégique identifiant dix grandes catégories de menaces. Parmi elles, l’approvisionnement énergétique figure en bonne place, qu’il s’agisse de pénurie ou de black-out. Comment anticiper de telles situations ? Quels outils le Canton met-il en œuvre pour répondre efficacement aux crises ? Denis Froidevaux, chef du Service de la sécurité civile et militaire et de l'État-major cantonal de conduite (VD), nous éclaire.

Monsieur Froidevaux, comment le Canton se prépare-t-il à des risques imprévisibles, notamment en matière énergétique ?
Quand on parle de gestion des risques, il faut distinguer trois axes principaux. D’abord, celui qui vise à limiter la survenance du risque via des mesures de prévention techniques, physiques ou organisationnelles, ensuite la réduction de l’impact des risques sur la société, les infrastructures ou le patrimoine et enfin la préparation des mesures qui permettront de gérer les crises lorsqu’elles surviennent, afin de revenir à la normale le plus rapidement possible. Dans le cas d’une pénurie énergétique, le Canton a peu de pouvoir pour diminuer la probabilité d’occurrence, car cela dépend de contextes externes. Nous nous concentrons donc sur la limitation des impacts et sur la capacité de réponse en cas de crise. Pour d’autres types de risques, comme les dangers naturels, nous avons davantage de leviers. Par exemple, nous investissons dans des ouvrages de protection – murs anti-éboulements, systèmes de rétention d’eau, etc.
Que peut faire la population pour se préparer à une pénurie énergétique ?
La responsabilité première de l’approvisionnement énergétique incombe surtout aux autorités, pas à la population. Mais chaque citoyen peut jouer un rôle, d’abord en réduisant sa consommation personnelle, domestique, mais aussi en se dotant de moyens pour limiter l’impact d’une crise, autrement formulé : en augmentant sa propre résilience. Cela peut paraître anachronique, mais disposer d’une radio à piles, constituer des réserves d’aliments et de boissons, ou prévoir des médicaments de réserve en cas de traitement régulier sont des gestes simples et essentiels. Nous vivons dans une société où, heureusement, nous avons été relativement épargnés par les grandes crises. Mais cela signifie aussi que nous sommes peu sensibilisés à la fragilité de notre système. Être prêt à gérer quelques jours sans aide extérieure est une manière de renforcer sa propre résilience.
Qu’avez-vous appris de la crise énergétique de l’année passée, liée au conflit ukrainien ?
La situation de l’année dernière nous a conduit à mettre en œuvre le plan de continuité de l’État (PCA), et donc à identifier les prestations critiques à maintenir à tout prix : par exemple, les ambulances, l’approvisionnement en carburant des véhicules de secours, ou encore l’approvisionnement en énergie des systèmes informatiques essentiels. Cela nous a permis de mettre en place des solutions de secours et d’améliorer la résilience de l’État face à un risque de pénurie. Mais il faut aussi accepter une réalité : le risque fait partie de la vie. On ne peut pas tout prévoir.
Quels risques sont prioritaires pour le Canton aujourd’hui ?
L’approvisionnement énergétique reste une grande préoccupation (inclus en gaz), notamment en hiver. Nous dépendons fortement du parc nucléaire français pour ce qui est de notre approvisionnement électrique, lequel rencontre des difficultés dans la maintenance de ses infrastructures. C’est un rappel que l’énergie ne fait pas partie des domaines où la Suisse est souveraine, ce qui est une réelle question. Nous surveillons également de près le risque de cyberattaques, qui prend de l’ampleur. Une attaque contre un fournisseur d’énergie pourrait avoir des effets en cascade, privant la population d’électricité. Les dangers naturels restent également une priorité. Nous constatons une intensité croissante des phénomènes climatiques. Par exemple, la crue centennale de la Morges était calculée à 36 m³/seconde ; or, l’été passé, elle a atteint 47 m³/seconde, provoquant des débordements inattendus. Personne n’avait prévu cela, car l’amplitude des phénomènes climatiques ne fait pas – encore – partie des scénarios de référence. Nous devons repenser nos modèles pour intégrer cette nouvelle réalité. Enfin, une autre catégorie qui nous a profondément marquée est liée aux risques pandémiques.
En même temps il faut être prudent, car trop de planification tue la planification. Vouloir tout prévoir peut étouffer l’initiative et la créativité des équipes au moment de gérer une crise, qui n’est jamais 100% conforme aux prévisions. Il faut garder une certaine créativité, une souplesse et une fraîcheur intellectuelle pour s’adapter à l’inattendu. C’est là que le génie humain des responsables en charge de la gestion de crise doit se manifester.
En tant que source d'information, le blog de Romande Energie offre une diversité d'opinions sur des thèmes énergétiques variés. Rédigés en partie par des indépendants, les articles publiés ne représentent pas nécessairement la position de l'entreprise. Notre objectif consiste à diffuser des informations de natures différentes pour encourager une réflexion approfondie et promouvoir un dialogue ouvert au sein de notre communauté.

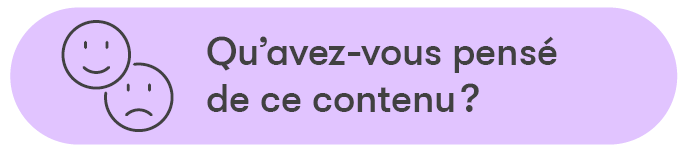


de la flexibilité et réduire la taille de la maille :
Microgrid,
Islanding
DER (decentralized Energies ressources) avec une prédominance de PV.
Grid-forming
Stockage individuel