Calquée sur le modèle du Traité de non-prolifération des armes nucléaires, une initiative propose un positionnement similaire sur les combustibles fossiles. Un projet ambitieux qui, même s’il peut sembler idéaliste et théorique, a tout de même le mérite de poser les jalons d’une fermeté politique manquante dans la lutte contre le dérèglement climatique. Explications.
Un traité de non-prolifération des combustibles fossiles, utopie ou levier politique incisif ?

L'essentiel en 3 points :
Le changement climatique constitue l'un des défis les plus pressants de notre époque, avec les combustibles fossiles – charbon, pétrole et gaz – responsables de près de 80 % des émissions de dioxyde de carbone depuis la révolution industrielle. Face à cette réalité, une initiative internationale propose un Traité de non-prolifération des combustibles fossiles (TNPCF). Son objectif : tenter d’impliquer les États pour encadrer et diminuer progressivement leur production et leur utilisation des combustibles fossiles.
Origine, ambition et vision de l’initiative
Inspiré par le Traité de non-prolifération des armes nucléaires, le TNPCF a été conçu pour aborder directement la source principale des émissions de gaz à effet de serre. L'idée consiste à créer un cadre international aussi incitatif que contraignant pour stopper l'expansion de la production de combustibles fossiles, réduire progressivement leur extraction existante et faciliter une transition équitable vers des énergies renouvelables. L’Initiative pour un traité sur les combustibles fossiles n’est autre qu’un projet mondial lancé par un comité directeur aux profils pluriels, composé à la fois de dirigeants de la société civile, de peuples autochtones, de jeunes militants, d'universitaires mais aussi d'experts.
L'adoption d'un tel traité implique des défis politiques majeurs, dépassant les seuls objectifs durables. En effet, adoptant un point de vue des plus réalistes quant à la question de l’exploitation des hydrocarbures, le projet prend en compte les impacts économiques et sociétaux essentiels liés aux États producteurs et à leur dépendance à cette manne économique. Les pays dont l'économie dépend fortement des combustibles fossiles pourraient logiquement percevoir ce traité comme étant une menace à leur souveraineté économique. De plus, les divergences entre les nations dites industrialisées et celles considérées comme étant en voie de développement entretiennent des divergences quant aux responsabilités historiques en matière d’émissions de CO2. Pour tenter d’y remédier et de favoriser les négociations, le TNPCF propose une approche différenciée. Sa proposition : demander aux pays historiquement les plus responsables et impliqués dans l’exploitation des combustibles fossiles de fournir des efforts accrus dans l’optique de soutenir les autres États dans leur politique de transition énergétique.
Enjeux sociétaux et énergétiques majeurs
Au-delà des considérations environnementales, le traité met ainsi l'accent sur une « transition juste ». Dans ce cadre, l’idée consiste à tenter d’amener des garanties pour que les personnes et les communautés dont l’activité principale dépend des industries fossiles ne soient pas laissées pour compte. Comment ? En tablant sur l’élaboration de programmes de reconversion professionnelle, des investissements stratégiques dans des secteurs alternatifs clés et des mesures de protection sociale jugées comme étant essentielles pour assurer que la transition énergétique puisse bénéficier à tous, sans accentuer le fossé des inégalités existantes.
Sur le plan énergétique, le TNPCF vise logiquement à accélérer le déploiement des sources d'énergie bas carbone. Ce qui nécessite d’investir massivement dans les infrastructures renouvelables ainsi que dans la recherche et le développement de technologies propres. En parallèle, le traité rappelle que des politiques incitatives plus incisives restent à mettre en place pour encourager l'efficacité énergétique et pousser la diversification du mix énergétique.
Le traité en trois principes clés
Le traité de non-prolifération des combustibles fossiles repose sur trois principes essentiels : la non-prolifération, l’abandon progressif de l’exploitation et la transition juste.
1. La non-prolifération vise à stopper progressivement l’expansion du charbon, du pétrole et du gaz, en mettant fin à toute nouvelle exploration et production. L’Agence internationale de l’énergie souligne qu’un avenir durable est possible, à condition qu’aucun investissement supplémentaire ne soit consacré à de nouveaux projets d’approvisionnement dans ces filières polluantes.
2. L’abandon progressif consiste à réduire progressivement les stocks et à mettre fin à la production de combustibles fossiles. Selon les données de 2018, pour respecter les objectifs climatiques, 60 % du pétrole et du gaz ainsi que 90 % du charbon doivent rester inexploités. La première étape implique d’identifier les réserves existantes et de limiter leur extraction. Grâce aux informations collectées par les entreprises pour des raisons environnementales, administratives ou économiques, il est aujourd’hui plus facile de suivre les quantités de combustibles fossiles que celles des émissions de gaz à effet de serre.
3. Enfin, la transition juste est indispensable pour atténuer les impacts sociaux de l’abandon des énergies fossiles. Cela inclut le soutien aux travailleurs des secteurs touchés, notamment par des programmes de reconversion professionnelle. Par ailleurs, garantir un accès équitable à l’énergie, en particulier pour les pays dits en voie de développement, est primordial. L’adoption de technologies bas carbone sera cruciale dans ce cadre. Plusieurs options de financement existent, notamment le réinvestissement des 7’000 milliards de dollars actuellement consacrés globalement aux subventions pour les énergies fossiles en faveur de la transition juste.
Soutien étatique officiel manquant
À ce jour, le TNPCF bénéficie du soutien de plusieurs villes et organisations, mais n'a pas encore été formellement ratifié par des États souverains. Le Parlement européen a cependant exprimé son soutien à cette initiative, appelant les États membres à s'engager dans cette voie. La ratification officielle par des pays nécessite ainsi davantage d’efforts de négociation afin d’espérer engendrer un consensus international. En termes de portée politique et énergétique au niveau international, s’il venait à être adopté, le TNPCF pourrait clairement transformer le paysage énergétique mondial. Politiquement, il établirait un précédent en reconnaissant la nécessité de limiter non seulement la consommation, mais aussi la production de combustibles fossiles. Surtout, il appuierait une vision pertinente et incisive de l’exploitation des combustibles fossiles et des émissions de CO2 en résultant comme étant une menace fondamentale pour l’humanité, au même titre que celle des armes nucléaires. Ce qui pourrait alors autant renforcer les engagements climatiques existants qu’encourager une coopération internationale accrue.
Si le Traité de non-prolifération des combustibles fossiles représente une approche audacieuse pour lutter contre le dérèglement climatique en s'attaquant directement à la source principale des émissions, son adoption généralisée sur la scène internationale présente des défis politiques, sociétaux, économiques et énergétiques majeurs. Reste qu’il offre une feuille de route inédite pour une transition équitable vers un avenir énergétique durable. La réussite de cette initiative dépendra de la volonté collective des nations à collaborer et à innover pour le bien commun.
En tant que source d'information, le blog de Romande Energie offre une diversité d'opinions sur des thèmes énergétiques variés. Rédigés en partie par des indépendants, les articles publiés ne représentent pas nécessairement la position de l'entreprise. Notre objectif consiste à diffuser des informations de natures différentes pour encourager une réflexion approfondie et promouvoir un dialogue ouvert au sein de notre communauté.

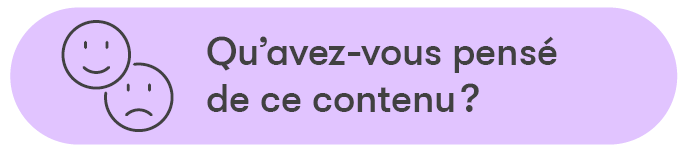


Commentaires 0